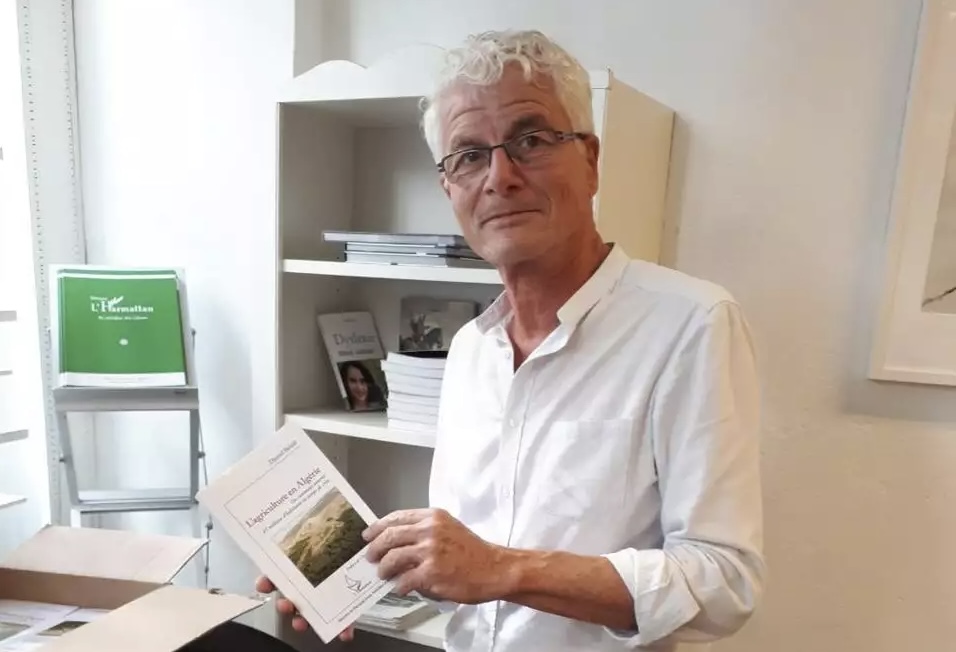Djamel Belaid: Un des éléments de réponse vient du pays voisin où les éleveurs estiment que l’annulation du sacrifice du mouton leur porte un tort énorme. En Algérie, déjà l’année dernière, les rumeurs d’importation de moutons avaient fait baisser les prix sur les marchés hebdomadaires et mis les acheteurs dans l’expectative.