Six jours durant, la 20ᵉ édition des Rencontres cinématographiques de Béjaïa a brassé des dizaines de films et autant de débats. On y a parlé de cinéma, bien sûr, mais aussi d’archives à restaurer, de mémoire à préserver, et de cette crise, réelle ou supposée, de l’imaginaire. Les œuvres projetées ont exploré quelques pistes : les hyènes des frontières dans le film de Lakhdar Tati, les fantômes du passé convoqués par Dania Reymond et Alaeddine Slim, ou encore la quête de dignité mise en scène par Anis Djaâd.
La cinémathèque de Béjaïa s’est révélé trop étroite pour contenir le nombre de spectateurs. Panorama partiel des films projetés lors de ces 20èmes Rencontres cinématographiques de Béjaïa.
Bin u Bin du réalisateur algérien Lakhdar Tati nous entraîne à l’est de l’Algérie, aux confins de la frontière tunisienne. Cela sent à plein nez le carburant de contrebande, avec des hyènes qui rôdent et des lézards qui circulent dans la nuit. Un village vit de ce commerce clandestin, jusqu’à l’arrivée d’un homme qui ne cherche pas l’aventure mais un moyen de financer un hypothétique film. Problème : dans ce monde fermé, il y a des règles, et les franchir peut coûter cher.
Le film est une plongée dans les paysages désolés et magnifiques du Ghouffi, entre réalisme et onirisme. Lakhdar Tati y installe une fable métaphysique, où les personnages citent à la fois El Zahi et Kierkegaard. Mais c’est un texte de Malek Haddad qui lui aurait inspiré le scénario. Lakhdar Tati y explore, ce bin u bin, cet entre-deux, la frontière, sous toutes ses formes: frontière géographique, mais aussi morale, politique, imaginaire et existentielle.
Le film reste obscur dans sa narration. Le réalisateur ayant trop recours à l’ellipse, préférant trop souvent le mystère à l’explication. Cela est frustrant mais le côté western abstrait n’en reste pas moins séduisant tant il est peuplé de personnages cabossés, interprétés par Slimane Dazi, Salim Kachiouche, Hanaa Mansour et Idir Benaibouche.
Sur certains aspects le film résonne en écho avec Agora du Tunisien Ala Eddine Slim, projeté le lendemain. Les deux films sont opaques, mais le résultat est très différent. Le réalisateur tunisien confirme sa maîtrise artistique: images habitées, poésie des cadres, univers énigmatiques. Slim explore la mémoire collective, les rapports troubles entre politique et religieux, et les vérités qu’on préfère enfouir.

Agora d’Alaa Eddine Slim confirme la vitalité du cinéma tunisien. Empêché de venir à Béjaïa pour raisons de santé, le cinéaste a néanmoins occupé l’espace des Rencontres grâce à l’universitaire tunisienne Insaf Mechta, qui a revisité son œuvre devant un public de professionnels et de cinéphiles de Béjaïa. Elle a projeté des extraits de son documentaire Babylone (réalisé avec Youssef Chebbi) et de son premier long métrage de fiction The Last of Us, montrant comment film après film, le réalisateur a mis l’humanité au cœur de son dispositif filmique, jusque dans ses fantasmagories.
Dans Agora, les disparus de la mer, les harragas, reviennent. Leur retour divise la communauté : accueillir les revenants ou les rejeter comme une malédiction. La mer, elle, crache des poissons morts en même temps que ses fantômes.
Étrange écho avec Les tempêtes, de la Franco-Algérienne Dania Reymond. Il y a, là encore, des revenants : cette fois, ceux de la décennie noire. On y suit le parcours de Nacer (Khaled Benaïssa) journaliste ayant perdu sa femme Fajar (Camélia Jordana) dans un attentat terroriste et qui est intrigué par une étrange poussière jaune qui recouvre la ville et qui ramène avec elles les fantômes du passé.

L’idée est forte, le scénario solide, le jeu convaincant. Mais la réalisatrice tend à y imprimer un ton grave et pesant presque factice. On peine à ressentir pleinement l’émotion, comme si la réalisatrice n’avait pas trouvé sa propre place face à ces fantômes. Ce décalage s’accentue avec l’usage dominant du français et même, par moments, du dialecte marocain. Résultat : un film qui paraît loin de notre algérianité, loin de notre mémoire collective. Dania Reymond assume : elle situe son récit dans un « pays imaginaire ». Mais elle concède aussi avoir dû composer avec les contraintes de production du CNC français, imposant la langue. Elle a également été contrainte, pour d’autres raisons, de délocaliser son tournage au Maroc.
Reste que Les tempêtes capte l’attention, surtout lorsqu’il ose toucher à la question politique. Cela s’illustre par une scène en particulier: Nacer, sous prétexte d’une interview, rencontre le terroriste repenti (Slimane Benouari) qui a assassiné sa femme. Le dialogue est frontal : « Qui t’a libéré ? », demante-t-il. « Le colonel », répond le repenti. Et Nacer de répliquer : « Ah oui… pas le juge ? ». Le film, alors, rejoint l’essentiel. Cette question de la justice est également posée lorsque les fantômes reviennent et ne comprennent pas pourquoi ils ont été arrachés à la vie.
La question de la langue, décidément récurrente, a trouvé un terrain fertile lors d’une table ronde animée par les autrices de la mini-série E’Sardine : la réalisatrice Zoulikha Tahar et l’écrivaine Kaouther Adimi. Débat sans filtre, où les deux autrices ont raconté leur bras de fer avec les financeurs pour limiter au maximum la part de français exigée. “Nous avons durement négocié pour maintenir la derdja dans la série. Elle y est à hauteur de 30%, confinée dans les espace où le personnage de Zouzou est avec son amie chercheuse, et encore, je trouve que c’est déjà beaucoup”, affirme la réalisatrice Zoulikha Tahar.
Pour elle, l’enjeu est intime : elle raconte un morceau de sa vie à Aïn Turk, près d’Oran. « Je pars de mon histoire pour raconter des histoires, parce que c’est là où je suis la plus sincère », dit-elle. Mais la sincérité a ses frontières : « Je ne veux pas présenter quelque chose qui fasse honte à ma famille », dit-elle. À ses côtés, Kaouther Adimi, qui vient de publier “ La joie ennemie”, un roman qui revient, encore, sur la décennie noire, confie de son côté : « Je suis une mauvaise fille ». Elle avoue ne laisser personne de son entourage lire ses manuscrits avant publication. Son seul garde-fou : « Ne jamais écrire quelque chose qui me fera honte dans 10 ou 20 ans ».
Ces dilemmes d’exposition intime, Anis Djaâd ne les a pas affrontés. Son long-métrage « Terre de vengeance », présenté aux RCB, trace une autre voie. Il s’agit d’un film dense et exigeant, marquant une certaine évolution artistique dans sa filmographie déjà riche. L’histoire suit Djamel, ancien corrompu fraîchement sorti de prison. Il veut retrouver son fils, reconquérir sa dignité, mais se heurte à l’hydre de la corruption et de la bureaucratie. Sa femme a disparu avec l’enfant, et chaque démarche administrative est une impasse.
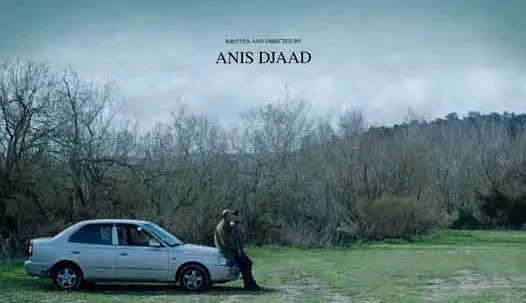
Le film baigne dans un gris oppressant, anxiogène jusqu’à l’étouffement. La lenteur y est calculée, dans une image aux accents mélancolique, épousant les blessures des personnages. Et les acteurs portent cette gravité: Samir El Hakim incarne avec justesse le rôle principal, soutenu par Meriem Medjkane, Rachid Benallal, Mohamed Mouffok, et et beaucoup d’autres talents issus du théâtre de Mostaganem.
Mais la grisaille du film d’Anis Djaâd n’a en rien entamé l’esprit de fête, de bienveillance et de curiosité qui a traversé ces 20e Rencontres cinématographiques de Béjaïa. Pendant une semaine entière, la cinémathèque de la ville a littéralement débordé : trop exiguë pour contenir la foule de spectateurs venus en masse, qu’il s’agisse de longs-métrages de fiction, de documentaires ou de courts-métrages
Hors les murs, l’ancienne place Gueydon est devenue un autre théâtre, celui où les habitants de Béjaïa et les cinéphiles de passage s’y sont mêlés aux artistes, dans une atmosphère décontractée. Beauccoup de vedettes du grand écran étaient présentes (Samir El Hakim, Slimane Dazi, Hanaa Mansour, Kader Affak, Camélia Jordana, Fianso, Mustapha Laribi, Ahmed Zitouni, Imen Noel, Adila Bendimerad…). Et pourtant, la plus grande ovation est revenue aux organisateurs et bénévoles qui ont réussi à créer un espace, où le septième art se pense, se débat et retrouve sa vocation première : rassembler.
