« El fen ou raï kharej men Bel Abbès ». Autrement dit : tout l’art, tout le raï seraient sortis de Bel Abbès. C’est ce que chante le groupe Raïna Raï dans la célèbre chanson « Zina ». L’affirmation est largement reprise, érigée en vérité d’origine.
« Faux », rétorque Mohamed Kali, auteur de l’ouvrage Raï, oh ! ma déraison, une histoire algérienne (paru aux éditions Chihab), lors d’une conférence consacrée à cette musique organisée à l’Institut français d’Alger. Pour lui, le raï n’est pas sorti de Sidi Bel Abbès. Pas plus que d’Oran ou d’une quelconque ville. « Dire que le raï est sorti de Sidi Bel Abbès, c’est une affabulation », dit Kali. Selon sa thèse, le raï n’est pas urbain. Il est rural. Il est né dans les chants de vigne, dans la terre et la misère des femmes, comme le blues est né dans les champs de coton.
« Le raï est né à la campagne. Dans la ruralité, les douars, les petits villages. Il n’entre en ville que tardivement, porté par les gens des campagnes, poussés par les exodes successifs vers les grandes cités, et surtout vers leurs périphéries, transformées en ceintures de misère », explique-t-il. D’ailleurs, le groupe Raïna Raï ne serait lui-même pas en phase avec le raï originel.
« Raïna Raï revendique un raï “propre”. Mais soyons clairs : se revendiquer d’un raï propre n’a aucun sens. Le raï a brandi l’étendard de la paillardise depuis sa naissance jusqu’à sa reconnaissance internationale. Ce n’est pas une imposture, c’est sa nature », dit Kali, avant d’ajouter : « En réalité, Raïna Raï s’inscrit dans la continuité de ce qu’il était à l’indépendance, et qu’il s’appelait alors Basil Session, avec un répertoire largement emprunté à la musique occidentale – du yéyé, du rock français. Un rock qui, en France, n’a jamais été une contre-culture comme aux États-Unis ou en Angleterre, où, en matière de mœurs, la société était corsetée. En France, sur le plan des mœurs, la société était déjà libérale (…) Donc la querelle Oran/Bel Abbès ne repose sur aucun fondement sérieux. »
Cette querelle serait ainsi profondément « masculiniste » et fait complètement l’impasse sur un fait essentiel : le raï est d’essence féminine. La question est de savoir comment, dans une société féodale, corsetée par le patriarcat au premier quart du XXᵉ siècle, une femme a-t-elle pu se tenir face à un public exclusivement masculin et chanter des paroles aussi licencieuses ?
Pour comprendre l’origine du raï, il faut remonter au premier quart du XXᵉ siècle, dans l’Algérie rurale, lorsque l’administration coloniale s’est lancée dans la culture de la vigne et que les femmes étaient encore confinées dans un espace domestique. « En ce temps-là, dit Kali, la femme doit être une ombre furtive, presque invisible. On ne doit reconnaître qu’elle est une femme que par ses vêtements. Rien dans sa démarche ne doit révéler sa féminité. Sinon, elle est accusée d’être aguicheuse. » Il rappelle qu’un vieil adage, encore répété aujourd’hui, dictait deux trajectoires dans la vie d’une femme : de la maison du père à celle du mari, puis de là… à la tombe. Toute existence autonome lui est niée.
Alors comment expliquer cette transgression radicale ? La réponse n’est ni poétique ni symbolique. Elle est économique et sociale. Mohamed Kali parle d’un « séisme sociologique ». Son nom : la viniculture. « Il a donc fallu un séisme sociologique pour que des femmes s’autorisent un désir de liberté. Ce séisme, c’est l’introduction à grande échelle de la viniculture. La viniculture, la vigne destinée au vin, existait déjà, marginalement, à l’époque romaine et ottomane. Mais elle explose après la destruction, à partir de 1863, des vignobles européens par le phylloxéra, un insecte destructeur. La colonisation en Algérie en profite pour relancer une agriculture rentable et alimenter la balance commerciale de la métropole », explique-t-il.
Et de poursuivre avec force détails : à partir de là, la viniculture devient une industrie massive. En 1914, l’Algérie produit 10 millions d’hectolitres, remplaçant 75 % du vin que la France importait d’Espagne et d’Italie. La viniculture devient la principale ressource de l’Algérie, au point où elle se classe en quatrième position des producteurs mondiaux de vin. À l’indépendance, elle est même classée première au sein de l’Organisation internationale du vin (OIV) et elle disposait, au sein de l’OIV, de deux sièges. « À ce moment-là, le vin rapporte plus que le pétrole. On l’oublie. On l’a effacé. On a arraché les vignes », glisse-t-il.
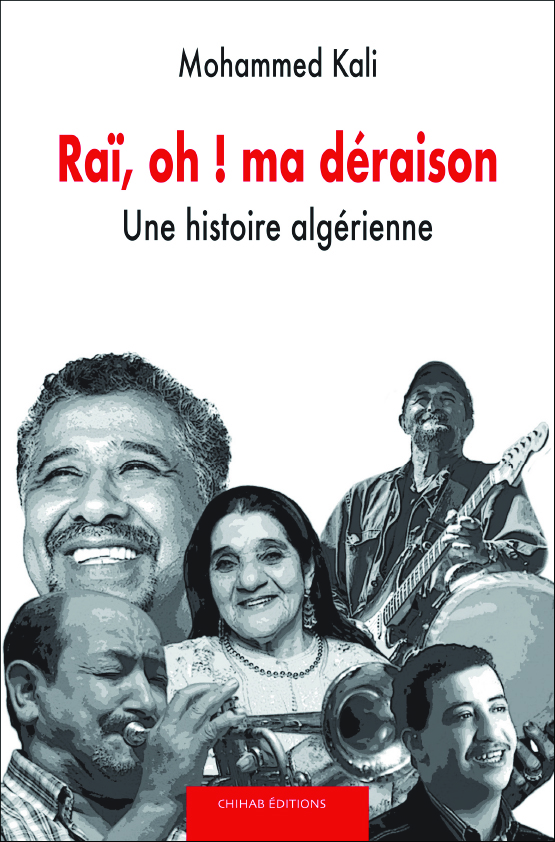
Les contingents de la détresse
Aussi la viniculture triomphante demande-t-elle une main-d’œuvre énorme : 80 jours de travail par an, contre 7 pour les céréales. Les hommes ne suffisent plus. On fait appel aux femmes pour les travaux des vendanges. C’était une première dans le monde rural, où les femmes n’effectuaient pas de travaux agricoles salariés.
Les femmes se mettent alors au travail. Kali les décrit comme des « contingents de la détresse » : des veuves, des orphelines, des femmes pauvres, des répudiées, des femmes battues, des femmes en rupture avec leurs familles. Par effet d’entraînement, d’autres femmes vont suivre pour mille autres raisons. « Leur statut au sein des ménages va évoluer. Les femmes du petit peuple, les “Fatma” corvéables à merci, vont entrer dans l’espace du travail salarié. Elles ramènent de l’argent au foyer. Leur statut change. Lentement, mais irréversiblement. Cela aura une incidence, sur la durée, sur la mentalité masculine », souligne-t-il. La vigne attire aussi une main-d’œuvre venue de loin : Hauts Plateaux, Sahara, Maroc…
« Dans des régions comme Témouchent, d’où je viens, avec des dizaines de milliers d’hectares de vignobles, imaginez ce que cela a produit comme mélange, comme frottement social. Cela relativise dans les esprits bien des certitudes. La ruée est particulièrement importante vers le nord-ouest du pays, où la viniculture est la plus implantée, constituant plus de la moitié de la superficie vinicole de l’Algérie, le climat étant propice car sec et chaud », raconte Kali.
Pour étayer ce lien, il cite le témoignage du poète marocain Ahmed Souhoum, recueilli par Radio Tanger. Parti jeune faire les vendanges à Béni Saf, sans argent, il raconte le travail dans les champs, les femmes qui faisaient les récoltes, les chants et les fêtes qui s’ensuivaient…
« Peu à peu, la femme est amenée à se détendre et à commencer à exister dans l’espace public. Le fait d’être productive au travail l’oblige à ne plus se soucier en permanence de son apparence, de la façon dont elle se couvre ou se découvre, du regard des autres, du qu’en-dira-t-on », dit Kali.
Il existe pourtant une autre théorie, souvent citée, y compris par des chercheuses importantes comme Marie Virolle, dont les travaux sur le raï, notamment sur Cheikha Rimitti, font autorité. Cette théorie situe la naissance du raï chez les bergers. « Marie Virolle a écrit parmi les pages les plus solides et les plus belles sur le raï. Or cette théorie, selon moi, ne tient pas », dit Kali.
Première raison pour laquelle Kali n’y croit pas : le berger est un solitaire. Il vit seul.
Deuxième raison : il ne joue de la flûte que par intermittence, quand son travail le lui permet.
Le matin, très tôt, vers cinq ou six heures, il sort avec son troupeau, l’amène là où il doit paître. Ce n’est que lorsque les bêtes ruminent que le berger est tranquille, qu’il sort la gasba, qu’il joue pour lui-même, qu’il raconte sa peine. « Sa vie est rythmée uniquement par ça. Ce n’est pas quelqu’un qui, le soir, va retrouver d’autres personnes. Donc l’idée de l’artiste-berger, sociologiquement, ne tient pas », dit-il.
L’hypothèse la plus solide, selon lui, se situe dans la rencontre entre des transfuges du bédoui, ces musiciens ruraux habitués aux fêtes, aux mariages, aux réseaux, et des cheikhat. Ces hommes jouent de la gasba, connaissent les circuits, savent capter l’attention. Les femmes, elles, portent la voix.
Kali présente des photos des vignobles pour montrer comment les sociétés rurales ont dû composer avec, en franchissant un interdit : celui de gagner sa vie dans un secteur d’activité qui n’est pas halal. « Les premiers jours de fermentation du vin produisent des effluves. Pendant quinze jours, tout le village en est imprégné. Même la mosquée. Et personne ne proteste. Ça veut dire que les gens font la balance. Ils pèsent le pour et le contre. Et ils deviennent, malgré eux, plus tolérants », explique-t-il.
Les vendanges bouleversent tout. Vendangeurs et vendangeuses, et même la population, sont entraînés dans une forme de tolérance relative. C’est cette tolérance qui permet l’émergence des premiers balbutiements du raï. Ils vivent une situation totalement inédite. Ce qui, au fil des années, devient presque banal. Coupés de leurs familles, ils passent près de trois mois à dormir à la belle étoile, sur les champs. Hommes et femmes se rencontrent autour des braseros. « Forcément, une communauté de destin se crée. Des solidarités, des amitiés. Des tensions aussi. On s’organise pour manger, pour partager, pour vivre ensemble », souligne Kali.
Le soir, autour du feu, quand la fatigue tombe, le chant s’impose. D’abord a cappella. « Les hommes entendent des ritournelles tristes ou gaies, chantées par les femmes à l’écart. Les femmes veillées reprennent entre elles une sorte de houfi. Comme ces femmes d’une même parenté, ou des voisines, qui se réunissent pour rouler le couscous. Ces chants, on les entend aussi dans les réjouissances, mais aussi dans le deuil. Le chant sert à cautériser la douleur », raconte-t-il.
Selon lui, on dit d’une femme qu’elle « houfi » quand, en pleurs après la mort d’un proche, elle hurle ou murmure sa peine avec des mots arrachés à l’émotion. C’est ce houfi qui préfigure le raï, selon Kali. « Il y a, parmi ces femmes, les sociables, les timides, les boute-en-train… Et comme dans toute vie collective, des rapprochements s’opèrent discrètement entre vendangeurs et vendangeuses. Les plus affranchies – les merioul ou merioulate, comme on les appelle – libérées de la pression sociale par l’anonymat, osent une parole de rupture avec le conformisme social. Cette complainte s’appellera raï. »
Pour Kali, raï, ici, ne veut pas dire raison, mais plutôt déraison – cela figure d’ailleurs dans le titre de son ouvrage : La déraison d’exister, de protester, de dire sa peine, sa colère, son injustice. « Les malheureuses le répètent en leitmotiv dans le chant. Mais cela peut être aussi une protestation contre la persécution dont il leur arrive d’être victimes », estime-t-il.
Et de citer, en exemple, une chanson de Cheikha Djenia où elle parle de solitude, de misère, d’enfants laissés seuls, de femmes broyées par le destin. Ce sont des textes d’une violence sociale extrême.
« Ouledha fi el dar »
Chanson de Djenia
Ses enfants sont au logis, sans elle
Clouée qu’elle est dans le cabaret
Les gens passent l’Aïd chez eux
Elle, elle est rivée au cabaret
Émiettée
C’est le sort des pauvresses
Maudits soient mes aïeux
Que la solitude me consume
J’ai abandonné ma maison
Emmenez-moi à Sidi Bel Abbès
Voir le petit El Hadi El Zine
Mon sang est envenimé
Les gens sont chez eux
Moi, nulle part, je trimarde pour mes petits
De quel droit médire d’El Djenia
Que Dieu anéantisse vos foyers
H’bibou, ils ont meurtri ta maman
Asséchant mon corps, j’ai pleuré des torrents de larmes…
Mais il y a aussi des chansons de franche paillardise, comme « Zoudj dabzou aliya » (« Deux se sont disputés mes faveurs »), de Cheikha Ouachma, dans laquelle elle passe en revue la liste de ses amants.
Raï vs bédoui : mêmes instruments, deux mondes
Il existe des confusions entre le raï et le bédoui. « S’ils utilisent les mêmes instruments, ils ne jouent pas la même partition, ni des textes semblables dans leur nature », souligne Kali, expliquant que le bédoui, plus ancien, s’est nourri des modes orientaux après l’islamisation du Maghreb, fruit d’un long syncrétisme culturel. Le raï, lui, emprunte un autre chemin : il puise dans les airs berbères, transmis par les femmes, hérités des mères et des grands-mères, portés par la mémoire orale.
« Ils ont adapté la gasba et le guellal, qui sont berbères. Cela s’est fait aussi avec la naissance d’une langue parlée, la derdja, qui a donné des trouvailles linguistiques comme la dénomination de la ville d’où je viens : Aïn Témouchent ; le premier est un terme arabe, le second est berbère. C’est dans ce vernaculaire que la poésie dite melhoun est née et dans laquelle s’exprime le bédoui », dit-il.
Mais là où le bédoui sacralise le texte, le raï le désacralise. « La base textuelle du raï en derdja, ce sont des paroles. Elles ne sont pas composées de manière à être fixées ad vitam aeternam. L’improvisation textuelle est la marque de fabrique du raï. Ses paroles peuvent varier, s’allonger ou raccourcir. Le ou la chanteuse est continuellement dans la performance, obéissant à l’instant, à sa pulsion créative, dans l’immédiateté de sa prestation sur scène », dit-il.
« Ce sont des paroles simples, oui, mais avec une musicalité. Il y a une répétition, des formules qui reviennent, mais elles sont chargées de sens.
Et parfois, le texte n’est même pas raï à l’origine. Il a été raïsé par la musique », estime Kali.
Les frontières, pourtant, ne sont pas étanches. Il existe une porosité entre les deux genres. L’exemple de Bakhta est parlant. Texte bédoui signé Cheikh Khaldi, la chanson entre dans l’histoire du raï quand Cheb Khaled la réinvente, portée par les arrangements de Blaoui Houari.
« Cheikh Khaldi était un ancien brigadier de police, instruit, parlait plusieurs langues. Il avait une femme et des enfants, ainsi qu’une maîtresse connue de tous, Bakhta, à qui il a consacré cinquante poèmes. C’était sa compagne de beuverie, tout le monde le savait et ça ne choquait personne. Le cheikh avait une autorité symbolique immense. Ce que la société refusait à la femme, elle l’acceptait chez lui. Les femmes artistes, en revanche, devaient se cacher, utiliser des pseudonymes. Ouachma portait une voilette pour qu’on ne reconnaisse pas son visage. Les gens voyaient ses poignets de main tatoués, et c’est de là qu’elle tient son nom de scène », fait remarquer Kali.
On oppose souvent la « noblesse » du bédoui à la supposée « paillardise » du raï. Là encore, raccourci. « Même dans le bédoui et le melhoun, il y a de la poésie paillarde et de la poésie amoureuse qui dit les choses crûment, rectifie Kali. Seulement, celle-ci était déclamée à la fin de la soirée, en petit comité, pour éviter qu’on les mémorise. Ce que l’histoire a retenu du bédoui, c’est surtout le panégyrique, el madh. Tout un pan transgressif a disparu. Et quand les cheikhs chantaient autour d’une grande théière, celle-ci était souvent remplie de vin ; la pénombre des lampes à pétrole faisait le reste. »
D’un autre côté, la paillardise, dans le raï, relève surtout de la contre-culture.
« Quand Hasni, le prince du raï sentimental, assassiné, chante “derna l’amour fi baraka m’ranka”, est-ce que ce n’est pas une protest song ? Est-ce que ce n’est pas une manière de dénoncer la misère affective et sexuelle imposée à toute une société ? Est-ce qu’on ne dit pas, au fond, qu’on a privé les gens du bonheur d’être ? », interroge Kali, rappelant que, dans les années 1970, les campagnes étaient surveillées, contrôlées.
Dans les années 1990-2000, on a vu la chasse aux couples non mariés. On demandait le livret de famille. Aussi, suggère-t-il, quand une chanson parle « d’aimer dans une baraque pourrie », ce n’est pas de la vulgarité gratuite. C’est une dénonciation.
La modernisation du raï
La modernisation du raï commence le jour où il cesse d’être exclusivement rural. « Il entre dans les villes par les quartiers périphériques. Le raï est entré avec les ruraux. Oran devient sa capitale parce qu’elle était la ville la plus européenne d’Algérie : 80 % de sa population était d’origine européenne. À l’indépendance, 80 % de sa population était d’origine rurale : il y a eu une rurbanisation monstre », souligne Mohamed Kali.
Les disquaires s’y multiplient. Le raï y explose. « Ailleurs, comme à Tlemcen, le raï arrive plus tard. Cela s’explique par le fait que l’économie, à Tlemcen, est constituée d’artisanat et de commerce. Il n’y a pas de citadins de Tlemcen qui acceptaient de faire les vendanges. C’est aussi une ville millénaire où il y a la musique andalouse. Idem pour Mostaganem. C’est une ville du bédoui, et celui-ci ne laisse pas le raï passer. C’est aussi une ville où l’andalou et le chaâbi sont bien établis », considère-t-il.
Deux se sont disputés mes faveurs
Cheikha Ouachma
Le troisième n’en savait fichtre rien
Le quatrième est sa Seigneurie le fermier
Le cinquième, que puis-je pour lui ?
Le sixième erre dans les rues
Le septième, mon cœur l’étreint
Le huitième, je l’ai livré aux tourments
Le neuvième est la prunelle de mes yeux
Le dixième est ma déchirure
Enfin, dire que tel chanteur a modernisé le raï à lui seul est faux. À Oran, certains ont voulu faire de Bouteldja Belkacem le grand modernisateur. « Impossible », selon Kali. Bouteldja Belkacem n’était ni musicien, ni compositeur, ni parolier. « Il a brillé par la reprise des tubes de Cheikha Ouachma. Tout petit, il accompagnait sa sœur, qui faisait partie de la troupe de meddahate de Ouachma. Il connaissait parfaitement son répertoire. Ce qui a prévalu, cela a été sa voix androgyne, qui interpellait l’oreille. C’est également sa sincérité et sa fougue dans l’interprétation qui ont fait son succès », dit-il.
Des éditeurs ont joué un rôle central. Ce sont eux qui remplacent la gasba par le violon, le qalouz par la derbouka. Les jeunes générations se citadinisent, écoutent l’asri wahrani. Ahmed Wahby et Blaoui Houari dominent la scène oranaise. Mais musicalement, le violon ne fait que transposer la gasba. Il l’imite. Il ne crée rien de fondamentalement nouveau.
Alors, introduire des instruments modernes suffit-il à parler de modernisation ? Pas vraiment. Messaoud Benllemou préférera l’appellation « pop raï », en faisant référence à la pop music, qui donnait à entendre de nouvelles sonorités, car il y a eu une fusion entre différents styles.
Bellemou joue de la trompette, un instrument sans quart de ton, alors même que le quart de ton est au cœur de la musique algérienne. Il commence dans les tribunes des stades : avant 1962, les pieds-noirs soutenaient leurs équipes à la trompette, les musulmans à la ghaïta. Bellemou va provoquer la ghaïta sur son propre terrain, reprendre des airs connus algériens à la trompette. Puis il s’essaie à reproduire des morceaux de musique proches du raï. Il y parvient partiellement.
Il ajoute alors le t’bal, le karkabou. Trois univers se rencontrent : airs ibériques, gnawa-diwane, raï. Là, selon Kali, quelque chose se passe. Là, il crée. Là, le raï change réellement de nature. La rupture n’est pas dans l’instrument, mais dans le fait que la musique précède désormais la chanson. Un nouveau langage sonore s’impose. Le raï n’est plus simplement « modernisé », il devient autre.
« Le violon est un instrument transpositeur, qui reproduit à l’identique la gasba. Il n’y avait rien de nouveau musicalement. La vraie rupture, elle vient quand la musique précède la chanson. Quand de nouveaux instruments créent un nouveau langage sonore. Là, oui, le raï change de nature », explique Kali.
Les éditeurs tentent alors d’y greffer une voix. On propose Bouteldja Belkacem à Bellemou. Ça ne fonctionne pas. Il reprend Ouachma à l’identique ; sa voix androgyne ne suffit pas à épouser ce nouveau paysage sonore. Deuxième tentative : Boutaïba Sghir. Lui, c’est autre chose. Compositeur, musicien, parolier, chanteur. Il cale sa voix sur la musique de Bellemou. Pour la première fois, un équilibre s’installe entre la voix et la structure musicale.
Un autre facteur va accélérer la diffusion à grande échelle : la cassette audio. « Les jeunes d’Oran partent faire leur service national avec des cassettes. Ils les font écouter à Alger, à Constantine, partout. Beaucoup de jeunes du centre et de l’est du pays sont venus en Oranie. Le service national a été un vecteur majeur de diffusion du raï », souligne Kali.
Ensuite, pour l’internationalisation, il y a eu un soutien politique, estime Kali. L’État comprend l’enjeu du soft power. « Il fallait donner une autre image de l’Algérie, moins austère. Le raï a d’abord circulé dans les quartiers d’immigration, à Barbès notamment. Quand on a vu que ça prenait, on a organisé. Et il faut le dire : l’un des artisans majeurs de cette exportation, c’est le colonel Senouci, un militaire », dit Kali.
Le talent des chanteurs fera le reste. Né dans la misère et dans les marges, la complainte de la déraison a quitté les champs de vigne et les braseros de fortune pour gagner les cabarets, puis les scènes, puis le monde.

