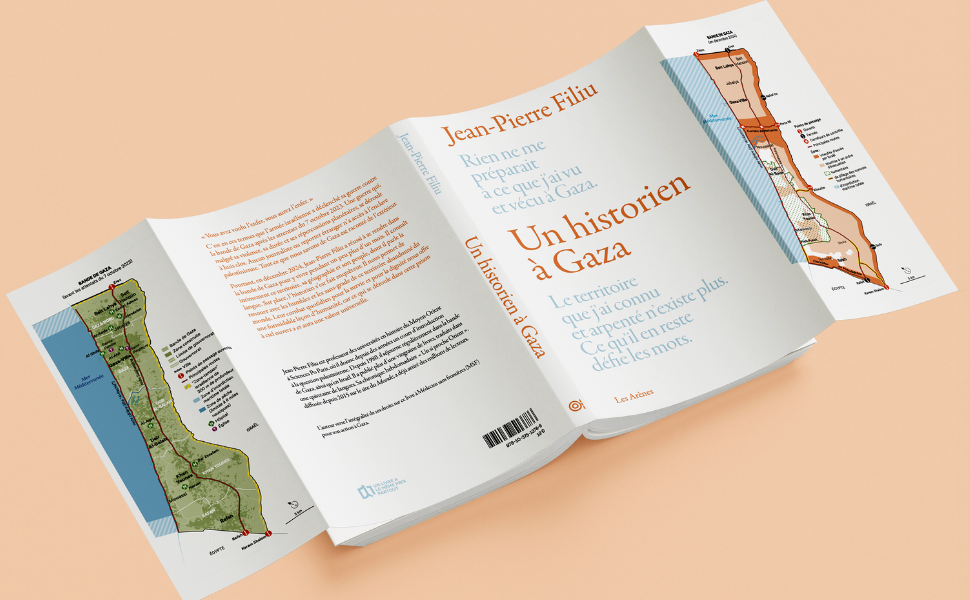Depuis près de deux ans, Ghaza vit sous le feu permanent, réduite à l’état d’enclave assiégée dont nul ne sort et où nul ne peut entrer. Les bombardements israéliens ont transformé ce territoire densément peuplé en un espace de silence et de ruines, inaccessible aux journalistes étrangers. C’est dans ce contexte d’occultation que Jean-Pierre Filiu, historien du monde arabe, a réussi à franchir le blocus en décembre 2024, grâce à une mission humanitaire. De son séjour d’un mois, il rapporte un récit à la fois intime et politique, « Un historien à Gaza », qui mêle enquête de terrain, mémoire historique et témoignage direct d’un peuple enfermé dans la guerre.
« Vous avez voulu l’enfer, vous aurez l’enfer. » Par cette formule implacable, l’armée d’occupation israélienne a justifié son offensive contre Ghaza. Depuis, les bombardements s’enchaînent, les destructions s’étendent, et la bande côtière s’enfonce dans un chaos sans répit. Le monde, lui, regarde de loin, à travers des bilans comptables et des images fragmentaires. Car Ghaza est devenue une guerre sans témoins : les journalistes étrangers y sont interdits. Les seuls à documenter la tragédie sont les habitants eux-mêmes, contraints de filmer, d’écrire, de raconter au milieu des ruines, exposés à la même mort que leurs proches.
En décembre 2024, Jean-Pierre Filiu est parvenu à fissurer le mur du silence qui entoure Ghaza. Historien du monde arabe, arabophone, familier de l’enclave qu’il a longuement étudiée, il a pu rejoindre une mission de Médecins sans frontières et vivre, du 19 décembre au 21 janvier, au cœur du siège.
De cette immersion est né Un historien à Gaza, un texte qui dépasse le simple reportage. Ce n’est pas un journal de bord comme les autres, mais le témoignage d’un chercheur devenu témoin direct, mêlant l’urgence du présent aux échos d’un passé que l’on voudrait effacer.
Le constat d’une disparition
« Rien ». C’est ainsi que Jean-Pierre Filiu ouvre son récit, pour dire l’effacement radical d’un territoire qu’il avait pourtant arpenté tant de fois. Rien ne subsiste de ce Ghaza familier, sinon l’ombre d’une ville dévastée, transformée en amas de gravats. Ce n’est plus un espace habité mais un paysage de disparition. Les repères de la vie quotidienne sont engloutis par la guerre.
Comment nommer une ville sans rues, sans écoles, sans quartiers ? Comment décrire un lieu dont la mémoire est pulvérisée autant que ses murs ? L’historien s’y essaie, en accumulant des images brèves, saisies dans l’urgence : familles fuyant à découvert entre deux détonations, enfants agrippés aux jambes de leurs parents, silhouettes hagardes qui transportent un maigre paquetage, gamins traînant des jerricans trop lourds dans une bataille interminable pour quelques litres d’eau.
Et partout, la mort qui rôde, qui frappe à l’aveugle et laisse derrière elle des fosses communes creusées à la hâte. Des écoles rayées des cartes, condamnant une génération entière à l’errance. Des quartiers entiers effacés comme si l’on avait voulu gommer la mémoire même de leur existence. Ghaza n’est plus seulement détruite. Elle est en train d’être effacée du langage, réduite à un non-lieu que l’historien tente désespérément de restituer.
Le privilège du passant
Jean-Pierre Filiu ne se berce d’aucune illusion sur son rôle. Son témoignage est précieux, mais il sait qu’il écrit depuis une place singulière : celle de l’étranger protégé. Protégé par son statut, par la mission humanitaire qui l’abrite, par la certitude d’un retour possible. À Ghaza, il a bu une eau filtrée, il a eu accès à une nourriture régulière, il a vécu dans la perspective d’un départ. Ce privilège, minime ailleurs, devient ici abyssal, car pour les habitants, il n’y a pas d’ailleurs, pas de refuge, pas de sortie.
Cette conscience traverse son récit. L’historien raconte sans détour la dissonance entre son expérience et celle des Ghazaouis. Lui était un visiteur de passage, eux sont prisonniers d’un territoire condamné à l’asphyxie. Il pouvait observer, noter, archiver. Eux, à chaque instant, risquaient de voir leur maison, leur école, leur famille s’effondrer sous les bombes.
Il pense aussi aux journalistes palestiniens, ces reporters sans autre protection que leur propre courage. Ils n’ont pas la possibilité de se retirer derrière un passeport. Les journalistes vivent l’histoire qu’ils racontent, sous l’œil permanent des drones et la menace continue des balles. Ils témoignent dans l’urgence, souvent au prix de leur vie. Et pourtant ils sont invisibilisés, effacés, parfois accusés de partialité alors qu’ils paient de leur sang la vérité.
En soulignant cette inégalité fondamentale entre celui qui observe et celui qui endure, Filiu ne cherche pas à s’ériger en porte-voix. Il se situe ailleurs : dans ce fragile espace où l’on tente de relayer la parole des survivants sans se l’approprier. Son livre devient alors un hommage implicite à ceux qui n’ont pas le choix, à ceux qui écrivent et filment non pas pour témoigner de loin, mais parce qu’ils n’ont pas d’autre manière d’exister face à l’effacement programmé.
L’histoire longue d’un territoire martyrisé
Jean-Pierre Filiu ne s’en tient pas à la description du chaos actuel : il inscrit Ghaza dans une continuité historique. Il rappelle que cette bande de terre, aujourd’hui réduite à des ruines, fut autrefois une oasis fertile, connue pour ses vergers d’agrumes, ses vignes, ses palmiers, pour son climat doux qui attirait les voyageurs. Ghaza fut longtemps un carrefour prospère, une terre d’échanges et de culture.
Mais Filiu insiste : l’effacement n’est pas seulement matériel, il est aussi symbolique. Détruire Ghaza, ce n’est pas seulement détruire des maisons ou des infrastructures, c’est tenter de faire disparaître la mémoire d’un lieu et d’un peuple. Chaque bombardement vise aussi les archives, les bibliothèques, les écoles, les lieux de culte, tout ce qui transmet une histoire et une identité.
En reliant le présent aux strates anciennes, l’historien déjoue cette entreprise d’effacement. Il montre que Ghaza ne peut être réduite à ses ruines actuelles : elle reste chargée d’une mémoire millénaire, celle d’un territoire martyrisé mais jamais effacé, dont la vitalité passée rappelle à quel point sa destruction contemporaine est un crime contre l’histoire autant qu’un drame humain.
La solitude d’un peuple
Parmi les paroles rapportées par Jean-Pierre Filiu, une résonne comme un couperet : « Le seul ami du Palestinien, c’est son âne. » Les institutions internationales multiplient les déclarations impuissantes. Les grandes puissances détournent le regard ou se contentent de justifier l’injustifiable, et les organisations régionales se taisent ou s’enlisent dans leur propre paralysie. Le verdict est sans appel : personne ne protège Ghaza, sinon Ghaza elle-même.
Dans ce désert de solidarité, les habitants s’accrochent à la seule force qu’il leur reste : la débrouille, la résistance quotidienne, le fragile tissu de solidarité qui unit encore les familles et les voisins. On partage un quignon de pain, on creuse un puits de fortune, on répare une roue de charrette pour transporter des jerricans. La survie s’improvise chaque jour, dans l’inventivité contrainte d’un peuple qui refuse de disparaître.
Ce que Filiu met en lumière, ce n’est pas seulement l’isolement diplomatique, c’est aussi la solitude existentielle d’un peuple condamné à n’avoir que lui-même comme recours. Être Palestinien, à Ghaza, c’est survivre sous les bombes, sous les décombres, mais aussi dans le vide politique laissé par un monde qui a choisi l’indifférence. La phrase de l’âne n’est donc pas seulement une boutade tragique : c’est le constat d’une humanité reléguée à la marge, contrainte de trouver dans la résistance du quotidien la seule forme de dignité encore possible.
Écrire contre l’effacement
Un historien à Gaza n’est pas un récit de guerre de plus, noyé dans le flot des images et des bilans. C’est une écriture dressée contre l’effacement. Jean-Pierre Filiu ne se contente pas de décrire les ruines, il s’oppose à la disparition programmée des voix, des visages et des mémoires. Il rappelle que derrière chaque chiffre des communiqués officiels, derrière chaque colonne de statistiques froides, se trouvent des prénoms, des histoires, des existences brutalement interrompues.
Son texte oblige à regarder ce que l’on voudrait ignorer : les familles pulvérisées en une seconde, les enfants qui ne reverront jamais l’école, les vieillards enterrés dans l’anonymat des fosses communes. À travers ses pages, il s’agit moins de documenter une guerre que de sauver une trace, de maintenir une humanité que l’on tente d’effacer sous les décombres.
En liant le présent à la mémoire longue d’un territoire martyrisé, l’historien refuse que Ghaza ne soit réduite à un champ de ruines sans histoire. Ses mots témoignent que, même au cœur de la destruction, demeure une dignité qui échappe à la logique des bombes.
Ce qui se joue à Ghaza dépasse de loin les frontières de l’enclave. Le territoire n’est pas seulement le théâtre d’un conflit local, il est devenu le miroir d’un monde où l’impunité des uns s’accommode trop bien du silence ou de l’impuissance des autres. Ce qui s’y déroule révèle les failles d’un ordre international qui proclame des principes mais reste incapable de les défendre lorsque l’épreuve est la plus rude.
Le témoignage de Jean-Pierre Filiu prend alors une portée universelle. Il ne s’agit pas seulement de porter la voix d’un peuple enfermé et frappé, mais de poser une question qui nous concerne tous : que vaut le droit s’il peut être bafoué au point qu’un territoire entier soit méthodiquement détruit sous les yeux de la communauté internationale ? Que vaut l’humanité si elle se contente d’assister, impassible, à l’effacement d’une société entière ?