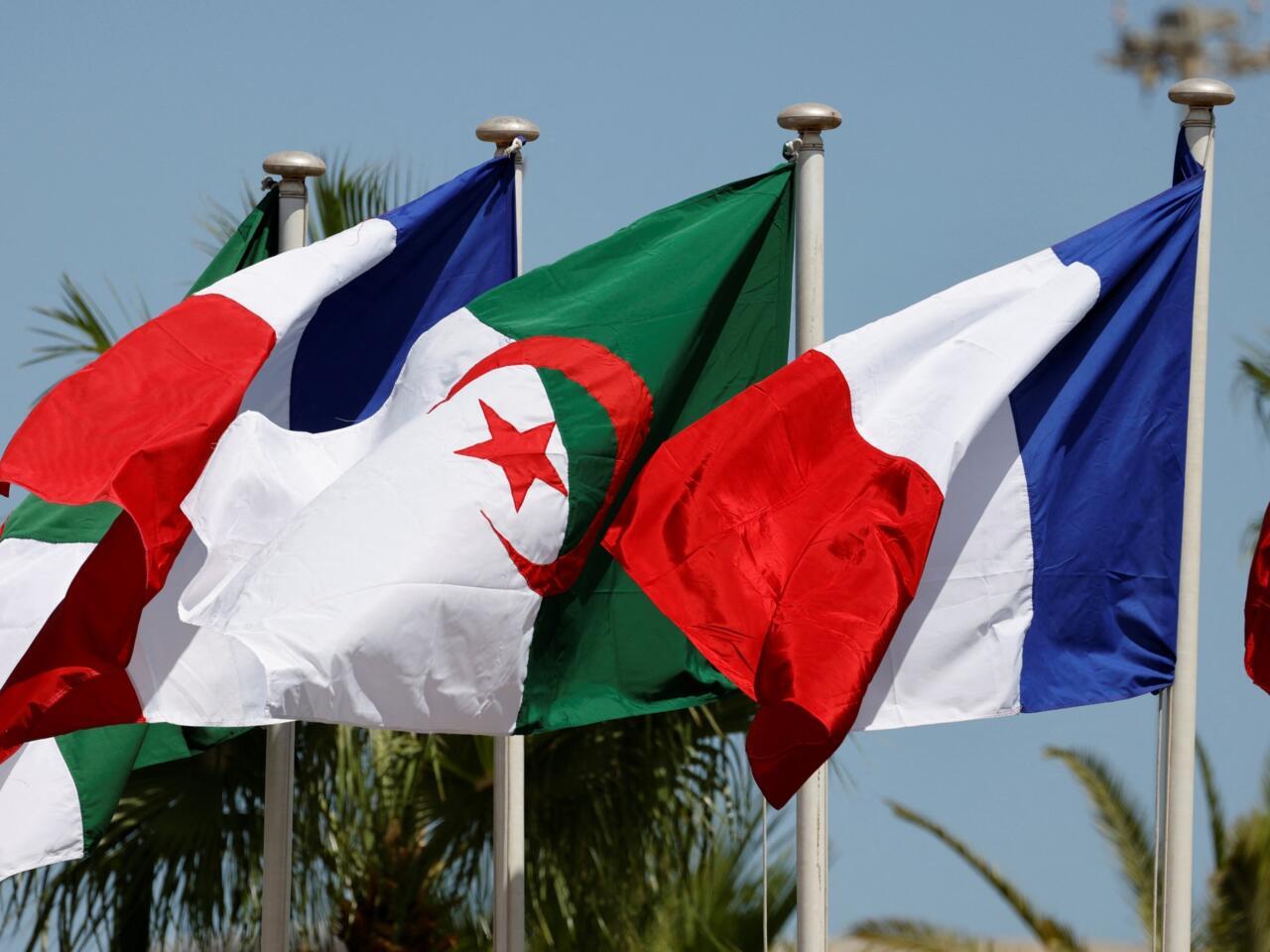La relation entre l’Algérie et la France s’installe dans une zone de silence. Alors que Paris multiplie les gestes symboliques pour rouvrir le dialogue – participation de son ambassadeur rappelé à Paris à la cérémonie d’hommage aux victimes du 17 octobre 1961, déclaration du nouveau ministre de l’Intérieur sur la nécessité de rétablir les canaux de communication – Alger reste muette.