C’est le monde grouillant des plantes en Nouvelle-Calédonie qui a inspiré ce travail. Les rapports interspécifiques – ritualisés ou non – sont d’une densité qui transcende toutes les visions anthropocentriques du vivant, de la vie et de ses ramifications métaphysiques et politiques. En fait, le sortir de terre de Boulbina est un retour à la terre, un devenir-végétal de l’humain.
Comment donc approcher le monde – l’existence – à partir d’une perspective végétale ? C’est la question fondamentale que pose la philosophe comme un défi à la réflexion philosophique. Comment peut-on approcher les descriptions et les analyses produites par l’anthropologie sans les reproduire ? Autrement dit, comment, au niveau théorique, sortir du culturalisme anthropologique qui a transformé l’ailleurs en un « ici », l’autrui en un « autre », une ontologie en un « croire », une métaphysique sensible en une « superstition ».
Ici, le sens du terrain prend toute son épaisseur : il n’est plus le lieu où mesurer la distance qui sépare l’humanité accomplie de ce qui n’est pas encore humain, il est plutôt un terreau, avec toutes ses composantes, organiques et inorganiques, animées et inanimées, où se tisse l’expérience, s’éprouve la pensée et s’effritent les dichotomies consacrées entre le physique et le métaphysique.
L’anthropologie a longtemps coupé l’anthropos et le « terrain » de leur au-delà et de leur en-deçà, qui ne sont perçus que comme la signification d’un non-sens, d’une anomalie. C’est la raison pour laquelle Luste Boulbina se tourne du côté de l’art pour sortir de l’impasse de l’anthropocentrisme. Le végétal et l’art du végétal permettent justement d’échapper à ces dualités établies et à leurs conséquences tant au niveau théorique que politico-éthique. Une décolonisation des savoirs – les sciences humaines en l’occurrence – se fait au prix d’une réelle déstructuration. Une métamorphose. C’est pourquoi on ne peut séparer la lecture de cet ouvrage de celle de Malaise dans la décolonisation, publié par l’auteure presque en même temps, mais aussi de son livre plus ancien, Le singe de Kafka, qui démonte les formes de déshumanisation liées aux colonialismes européens.
D’où l’impératif épistémologique d’une nouvelle approche, en mesure de suivre les devenirs, non pas pour en fixer les généalogies, mais pour explorer les horizons auxquels ils tendent. Une approche créative donc, qui, du végétal au minéral, du minéral à l’humain, ouvre sur les devenirs cosmiques de notre espèce. Ici, comme le fait la philosophe, la critique de l’animisme en anthropologie – et de l’idéologie évolutionniste qui le porte – est toujours d’actualité. Car il ne s’agit pas seulement d’une déclassification des métaphysiques non discursives, mais d’un déclassement de la métaphysique tout court, avec toutes les dérives qui en découlent, notamment une dépréciation « rationaliste » des autres formes du socius. D’où l’animalisation des altérités « primitives » et « sauvages » – une animalisation qui part d’emblée d’une violente dévaluation de la vie animale.
D’où les missions civilisatrices. D’où les colonialismes. D’où les extractivismes débridés. D’où les écocides. D’où les génocides.

Ce que propose Luste Boulbina rappelle à maints égards la re-spécification de l’anthropologie par Amade-Ouatef M’charek, en tant qu’« art de porter attention » – the art of paying attention. L’art d’être attentif à toute trace et à tout fragment de vie, matérielle et immatérielle, pour ainsi imaginer la trame des histoires oubliées ou niées. L’art d’être attentif implique ainsi d’aller au-delà de l’emprise des savoirs institués, pour explorer l’esthétique que font les gens de leurs expériences, de leurs corps.
En montrant combien l’art, sous toutes ses formes, s’étend au végétal lui-même, Luste Boulbina élucide la richesse des expressions artistiques, qui, elles aussi, comme les savoirs, ont été soumises à la classification et au classement. Elle écrit :
Largement inconnues encore, du fait de l’organisation et de la division des savoirs académiques, mais aussi des préjugés qui, aujourd’hui encore, font des peuples autochtones des parias de l’humanité, ces expressions ont été minorées et subalternisées, quand elles n’ont pas été exoticisées. Certaines formes de l’art humain ont été regardées de haut, comme des manifestations serviles des « besoins » d’une population, au lieu d’être admirées comme des témoignages directs de l’ingéniosité et de l’inventivité poétique. L’igname en est un exemple remarquable. L’indifférence aux personnes et l’enfermement dans l’anonymat ont constitué les voies de l’infériorisation, a fortiori lorsque ces expressions artistiques sont liées, de multiples manières, au végétal et à la végétation locale. Le « besoin » et la « nécessité » ont masqué la liberté et le choix qu’il y a dans l’identification au non-humain, vivant et végétal.
L’igname est en effet un exemple remarquable. En tant que rhizome, proliférant et multiplicateur, elle incarne ainsi une nomadologie qui permet, au niveau de la méthode et de l’analyse, d’échapper à la reproduction (d’une force ou d’une structure), à l’alternative de l’un et du multiple, de l’au-delà et de l’en-deçà, du dehors et du dedans, du commencement et de la fin.
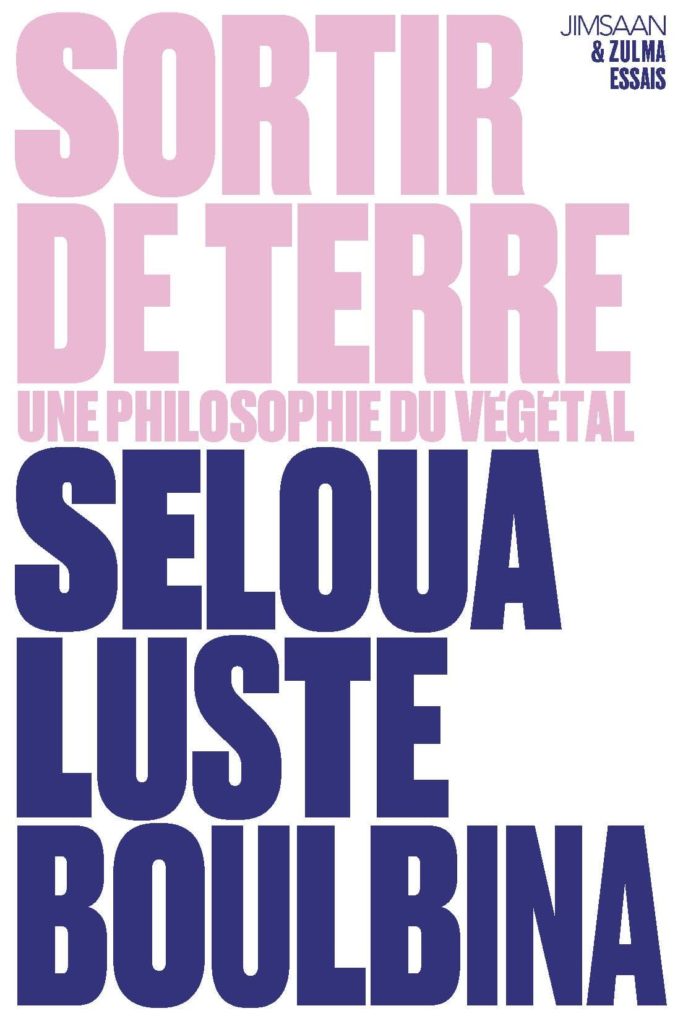
Inspirée par Deleuze et Guattari, Luste Boulbina illustre comment l’igname personnifie une anti-généalogie. C’est là une critique du foucaldisme – c’est-à-dire de ce qu’on a fait de Foucault en anthropologie. Il s’agit également d’une critique de la notion d’enracinement (territorial, idéologique), mais aussi de celle de race. Les deux vont ensemble : à l’instar de certaines racines qui prennent tout sur elles et tuent alentour.
Tige souterraine, déracinée, démultipliée et étendue en réseau, le rhizome se joue des systèmes préétablis, centrés et hiérarchiques. Le rhizome est de l’ordre de l’expérience déstructurante. D’un devenir. Comment devenir végétal ? Comment vivre, penser et écrire comme une igname ? La philosophe en donne des réponses, à travers notamment le choix et la lecture inspirés de certaines œuvres d’art et de fiction. Elle montre comment de telles métamorphoses sont vécues et performées.
À l’instar de l’artiste nigérian Jelili Atiku qui, à travers ses œuvres et expositions, se transmute en végétal : buisson touffu, arbre immobile, arbre enrobé de plastique, arbre aux branches mortes. Plante sacrée. Un végétal qui survit aux assauts de l’exploitation.
L’auteure montre bien également comment une expérience imaginaire comme celle de Robinson, le protagoniste du texte de Michel Tournier Vendredi ou Les limbes du Pacifique, articule fort bien ces potentialités de devenir non-humain de l’humain et leur horizon décolonial. Perdu, égaré, Robinson cherche l’enfoncement dans la terre. Il se réfugie dans une grotte pour se couper du monde, de lui-même, pour ainsi renaître autrement. L’expérience de la grotte dit la portée métaphysique de la terre, puisqu’elle incarne l’espace-temps des rencontres avec l’invisible, avec la mort, ainsi que celui des devenirs non-humains de l’humain.
Peu à peu, Robinson, au fond de sa grotte, se déshumanise, ne marchant plus qu’à quatre pattes, puis se traînant au sol, sur le ventre. Il n’est plus l’homo sapiens ni l’homo erectus qu’il fut. Il plonge dans un temps cosmique et s’exhume de la vase tel un végétal singulier. Le terrestre et le céleste disparaissent, ainsi que le présent et le futur, l’un et le multiple, le dedans et le dehors, l’immanence et la transcendance. Il s’agit certes d’une manière de mourir, mais elle est aussi une issue de survie, face à l’irrespirable expérience d’engloutissement, à la folie meurtrière de la déshumanisation.
Comme si le salut de l’humain – son achèvement – résidait dans un retour aux sources végétales et minérales de la vie.

