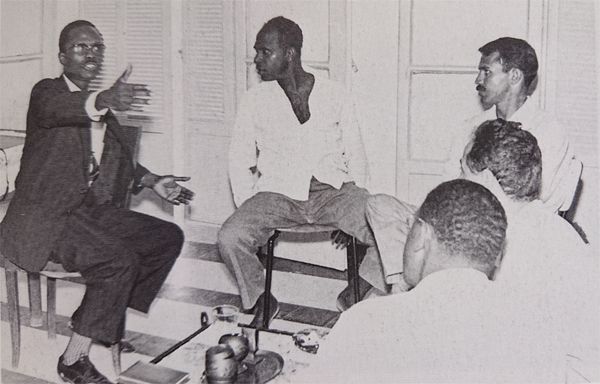À Alger, en décembre, le centenaire de Frantz Fanon ne se contente pas de rappeler la trajectoire d’un intellectuel révolutionnaire. Il interroge notre capacité collective à transmettre, relire et mobiliser nos propres penseurs à un moment où les lignes de fracture mondiales s’approfondissent.